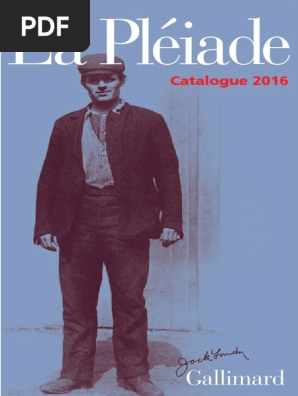0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
42 vues6 pagesMa Boheme
Le poème "Ma Bohème" d'Arthur Rimbaud, situé à la fin des Cahiers de Douai, illustre son art poétique à travers des thèmes de vagabondage et de nature. Rimbaud y exprime sa quête de liberté et son rejet des conventions sociales, tout en parodiant le style romantique avec humour et autodérision. Ce poème devient ainsi un manifeste d'une poésie nouvelle, célébrant l'errance et la créativité.
Transféré par
ilovecalculationCopyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
42 vues6 pagesMa Boheme
Le poème "Ma Bohème" d'Arthur Rimbaud, situé à la fin des Cahiers de Douai, illustre son art poétique à travers des thèmes de vagabondage et de nature. Rimbaud y exprime sa quête de liberté et son rejet des conventions sociales, tout en parodiant le style romantique avec humour et autodérision. Ce poème devient ainsi un manifeste d'une poésie nouvelle, célébrant l'errance et la créativité.
Transféré par
ilovecalculationCopyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
/ 6